-
 NBA: les LA Clippers échangent James Harden à Cleveland contre Darius Garland
NBA: les LA Clippers échangent James Harden à Cleveland contre Darius Garland
-
Les graffiti de Pompéi mis en lumière par la science

-
 En Thaïlande, le parti favori des jeunes craint d'être à nouveau écarté du pouvoir
En Thaïlande, le parti favori des jeunes craint d'être à nouveau écarté du pouvoir
-
A Washington, la diplomatie du minerai

-
 Fin de vie: après le rejet du Sénat, la loi sur l'aide à mourir revient à l'Assemblée
Fin de vie: après le rejet du Sénat, la loi sur l'aide à mourir revient à l'Assemblée
-
Les députés votent sur l'avenir des barrages français

-
 Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abou Dhabi pour négocier la paix
Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abou Dhabi pour négocier la paix
-
Venezuela: des milliers de partisans de Maduro dans la rue pour réclamer son retour

-
 Foot: N'Golo Kanté quitte l'Arabie saoudite pour Fenerbahçe
Foot: N'Golo Kanté quitte l'Arabie saoudite pour Fenerbahçe
-
Trump et Petro trouvent un terrain d'entente

-
 Deschamps et les médias: "accepter la critique" et "faire passer un message"
Deschamps et les médias: "accepter la critique" et "faire passer un message"
-
Les Etats-Unis tournent la page de la paralysie budgétaire

-
 Coupe du Roi: le FC Barcelone premier qualifié pour les demies
Coupe du Roi: le FC Barcelone premier qualifié pour les demies
-
Coupe de France: un peu de réconfort et un quart de finale pour l'OM

-
 Libye: Seif al-Islam Kadhafi tué par "un commando de quatre personnes" chez lui
Libye: Seif al-Islam Kadhafi tué par "un commando de quatre personnes" chez lui
-
Le président de la Colombie affirme que Trump a accepté de jouer les médiateurs avec l'Equateur

-
 Wall Street en recul, pénalisée par la tech
Wall Street en recul, pénalisée par la tech
-
Après une année 2025 "record", Santander va acquérir la banque américaine Webster Bank pour plus de 10 mds EUR
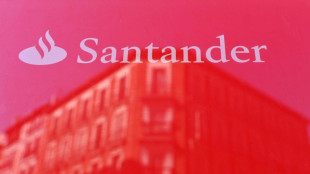
-
 Libye: Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt, tué par des hommes armés (conseiller)
Libye: Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt, tué par des hommes armés (conseiller)
-
En Finlande, les doutes affleurent après le contrat de fourniture de brise-glaces aux Etats-Unis

-
 Libye: Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt, est mort
Libye: Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt, est mort
-
Le Congrès américain vote la fin de la paralysie budgétaire

-
 Affaire Epstein : la police londonienne ouvre une enquête criminelle visant l'ex-ambassadeur Peter Mandelson
Affaire Epstein : la police londonienne ouvre une enquête criminelle visant l'ex-ambassadeur Peter Mandelson
-
Washington abat un drone iranien mais les discussions restent programmées

-
 L'Espagne veut lutter contre les contenus illégaux sur les réseaux sociaux
L'Espagne veut lutter contre les contenus illégaux sur les réseaux sociaux
-
Face aux accusations de discrimination, ses proches défendent la mémoire de Samuel Paty

-
 Procès RN: cinq ans d'inéligibilité requis en appel contre Marine Le Pen
Procès RN: cinq ans d'inéligibilité requis en appel contre Marine Le Pen
-
Trump reçoit discrètement le président colombien

-
 Prêt-à-porter enfant: le groupe IDKIDS (Okaïdi) placé en redressement judiciaire
Prêt-à-porter enfant: le groupe IDKIDS (Okaïdi) placé en redressement judiciaire
-
La fin de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis attendue au Congrès

-
 La Bourse de Paris termine à l'équilibre, en pleine semaine de résultats d'entreprises
La Bourse de Paris termine à l'équilibre, en pleine semaine de résultats d'entreprises
-
Le constructeur de véhicules électriques chinois BYD prévoit un modèle spécifique pour l'Inde

-
 Trump reçoit le président colombien pour amorcer un dialogue
Trump reçoit le président colombien pour amorcer un dialogue
-
Affaire Epstein : l'ex-ambassadeur Peter Mandelson quitte la Chambre des Lords

-
 Les Etats-Unis misent sur un Venezuela "démocratique", selon la cheffe de leur mission diplomatique
Les Etats-Unis misent sur un Venezuela "démocratique", selon la cheffe de leur mission diplomatique
-
"Production, préservation, protection": Macron veut rassurer les agriculteurs avant leur Salon

-
 Syrie: les forces gouvernementales entrent dans le bastion kurde de Qamichli
Syrie: les forces gouvernementales entrent dans le bastion kurde de Qamichli
-
Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit invoque des rapports consentis

-
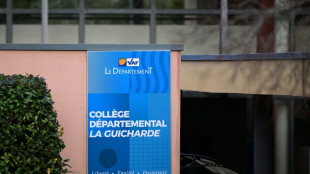 Une professeure entre la vie et la mort, poignardée par un collégien en classe dans le Var
Une professeure entre la vie et la mort, poignardée par un collégien en classe dans le Var
-
Le groupe Disney choisit Josh D'Amaro, responsable des parcs d'attractions, comme futur patron

-
 Abiy accuse l'Erythrée de "massacres" durant la guerre au Tigré, "mensonges" selon Asmara
Abiy accuse l'Erythrée de "massacres" durant la guerre au Tigré, "mensonges" selon Asmara
-
Ski: Lindsey Vonn confirme qu'elle participera aux JO-2026 malgré sa blessure

-
 Une professeure poignardée par un collégien en classe dans le Var, son pronostic vital engagé
Une professeure poignardée par un collégien en classe dans le Var, son pronostic vital engagé
-
La Colombie extrade un criminel vers les Etats-Unis peu avant une rencontre Petro-Trump

-
 TikTok, X, Kick ou Telegram: ces plateformes visées par la justice française
TikTok, X, Kick ou Telegram: ces plateformes visées par la justice française
-
Le rappeur Doums condamné à huit mois de prison avec sursis pour violences conjugales

-
 "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
"Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
-
Procès RN: l'accusation dénonce la "stratégie de délégitimation" et va requérir des peines d'inéligibilité

-
 Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
-
La Russie condamnée pour "traitements inhumains" de l'opposant Alexeï Navalny par la CEDH

Soudan, massacres impunis?
Le 15 avril 2023, une lutte de pouvoir au sein du régime militaire soudanais a basculé en guerre ouverte entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR). Depuis, les combats se sont propagés des rues de Khartoum aux plaines du Darfour et du Kordofan. En près de trois ans, la guerre a plongé le Soudan dans l’un des pires drames humanitaires de la planète. Les batailles se déroulent souvent au milieu des villes, transformant les quartiers en champs de ruines et laissant derrière elles des fosses communes. Les attaques aériennes et l’artillerie visent régulièrement des zones densément peuplées, et des témoins rapportent des actes de torture, de viol et de pillage. Cette violence ne montre aucun signe d’apaisement.
El‑Fasher, symbole du nouvel horizon de l’horreur
À la fin octobre 2025, après cinq cents jours de siège, les FSR ont pris le contrôle d’El‑Fasher, capitale du Darfour‑Nord. Cette ville d’un million d’habitants est devenue un piège pour les civils. Des milliers de personnes ont été massacrées lors de l’assaut. Le 28 octobre, l’unique maternité encore fonctionnelle a été prise d’assaut : plus de 460 patients et accompagnants y ont été exécutés, et six soignants enlevés. Les forces paramilitaires ont pénétré les quartiers, allant de maison en maison, tuant « à froid » les personnes qu’elles trouvaient. Des témoins ayant réussi à fuir décrivent des rues jonchées de cadavres, des femmes agressées et des enfants abattus en tentant de se réfugier vers des camps. Il est désormais impossible de connaître le nombre exact de victimes : des images satellites montrent des corps empilés près des murs de terre qui entourent la ville.
La prise d’El‑Fasher a provoqué un déplacement massif. Plus de 28 000 habitants ont été forcés de fuir en quelques jours vers la ville voisine de Tawila, déjà saturée par 575 000 déplacés. Au moins 260 000 personnes sont toujours piégées dans El‑Fasher sans accès régulier à l’eau, à la nourriture ou aux soins. Les services de santé ont été détruits et une épidémie de choléra fait rage : en 2025, la région a enregistré plus de 18 000 cas et plus de 600 décès. La faim est omniprésente ; depuis février 2025, l’aide humanitaire ne parvient plus à pénétrer dans la ville, et la famine se répand parmi les enfants et les femmes enceintes.
Le Darfour, théâtre de massacres répétitifs
Le drame d’El‑Fasher n’est pas un accident isolé. Dès 2023, les FSR et des milices alliées ont mené une campagne de nettoyage ethnique contre les populations non arabes de l’Ouest‑Darfour. La ville d’El‑Geneina a été le théâtre d’une série d’attaques ciblant la tribu Massalit : des villages entiers ont été détruits et des milliers de civils massacrés. Selon des données fournies aux Nations Unies, jusqu’à 15 000 personnes ont été tuées dans cette ville entre avril et novembre 2023. Des survivants ont décrit des exécutions sommaires, des charniers et des femmes violées en public. Les organisations humanitaires rapportent que des miliciens séparaient hommes et femmes aux points de contrôle et exécutaient d’une balle dans la tête ceux identifiés comme Massalit.
En 2024 et 2025, cette violence s’est étendue. En janvier 2025, une frappe de drone sur un hôpital d’El‑Fasher a tué des dizaines de personnes. Au printemps, les paramilitaires et l’armée régulière se sont affrontés dans l’État de Gezira ; un village y a vu au moins 26 civils massacrés, tandis que d’autres localités ont subi des exécutions sommaires, des viols et des pillages. En août 2025, environ 90 civils ont été tués en dix jours dans l’ouest du pays. Les tirs de roquettes et les bombardements aériens visent même des marchés et des mosquées : la frappe du 19 septembre 2025 contre une mosquée d’El‑Fasher a fait près de 80 morts. Ces crimes sont qualifiés de violations graves du droit humanitaire et, pour certains, de crimes contre l’humanité.
Une catastrophe humanitaire sans précédent
La guerre a provoqué un effondrement total des services publics. Près des deux tiers des Soudanais ont désormais besoin d’une aide d’urgence : plus de 30 millions de personnes manquent de nourriture ou de soins. La famine touche au moins cinq régions et affecte plus de 600 000 personnes. Les familles enterrent leurs morts dans des terrains vagues faute de pouvoir accéder aux cimetières, et certains quartiers de Khartoum servent de cimetières improvisés. Les conditions sanitaires favorisent les épidémies : plus de 33 millions de personnes, dont six millions d’enfants de moins de cinq ans, sont exposées au choléra. L’Organisation mondiale de la santé a recensé des dizaines de milliers de cas dans le Darfour et plus de 600 morts liés à la maladie en 2025.
Les déplacements sont massifs. Depuis le début des combats, près de 13 millions de personnes ont quitté leur foyer et plus de 4 millions se sont réfugiées dans les pays voisins, principalement au Tchad, en Égypte et au Soudan du Sud. Les camps frontaliers sont saturés, et les réfugiés manquent d’abris, de nourriture et de médicaments. Les femmes et les enfants représentent la majorité de ces réfugiés et sont particulièrement exposés à la violence sexuelle et aux enlèvements.
Crimes commis par toutes les parties
Si les massacres d’El‑Fasher ont mis en lumière les exactions des FSR, l’armée soudanaise (Forces armées soudanaises ou FAS) n’est pas exempte de responsabilités. Des bombardements aériens indiscriminés ont tué des civils à Tora et dans d’autres villes, et des unités alliées à l’armée ont mené des attaques contre des villages entiers. Dans l’État de Gezira, des milices agissant aux côtés des FAS ont intentionnellement ciblé des civils en janvier 2025, tuant au moins 26 personnes dans le village de Tayba. Des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des actes de torture ont été signalés aussi bien dans les zones contrôlées par les FAS que dans celles sous domination des FSR.
Les organisations de défense des droits humains estiment qu’aucune partie ne respecte ses obligations au regard du droit international humanitaire : les FSR ont exécuté des civils, violé des femmes et utilisé la famine comme arme de guerre en empêchant l’arrivée de l’aide humanitaire, tandis que l’armée a mené des frappes sans discernement et empêché l’accès des secours dans certaines zones. Les experts soulignent que ces violences relèvent de crimes de guerre et, dans certains cas, de crimes contre l’humanité. L’impunité persistante encourage les belligérants à poursuivre leurs exactions.
L’ombre des complices internationaux
La guerre du Soudan n’est pas une affaire purement locale. Malgré un embargo sur les armes visant la région du Darfour depuis 2005, les flux d’armes et de munitions se sont intensifiés. Des enquêtes indépendantes ont mis au jour l’utilisation de bombes guidées et d’obusiers récemment fabriqués. Ces armes, de conception chinoise, ont été fournies par un pays du Golfe, qui les a ensuite réexportées vers les paramilitaires soudanais. Des fragments de bombes récupérés après une frappe de drone près d’al‑Malha en mars 2025 portent des marquages indiquant une fabrication en 2024 ; des experts affirment qu’ils proviennent d’un appareil de type Wing Loong II ou FeiHong‑95, utilisé exclusivement par les FSR et fourni par cette même puissance étrangère.
Au-delà des transferts d’armement, des avions-cargos chargés d’équipements militaires auraient atterri des dizaines de fois sur une piste proche de la frontière tchadienne, acheminant des drones, des munitions et du matériel logistique aux paramilitaires soudanais. Cette violation de l’embargo contribue directement à la capacité des FSR à mener des offensives sanglantes. Certains responsables occidentaux reconnaissent que les réseaux financiers qui alimentent les FSR passent par des sociétés off‑shore et des compagnies établies dans plusieurs pays du Golfe. La valeur de l’or soudanais exporté clandestinement a augmenté, fournissant aux paramilitaires une source de financement, tandis que le commerce de viande et de bétail sert de couverture au trafic d’armes.
Ces révélations ont provoqué une onde de choc dans la diplomatie. Face à la pression internationale, des représentants de ce pays du Golfe ont admis publiquement avoir commis une erreur en soutenant la prise de pouvoir militaire en 2021 et en n’imposant pas de sanctions aux généraux responsables. Toutefois, ils continuent de nier toute fourniture d’armes. Des observateurs estiment que l’ambition de contrôler les mines d’or soudanaises et les terres agricoles fertiles pourrait expliquer cet engagement. Les investissements passés dans les ports et les banques soudanais témoignent de l’intérêt stratégique de ces acteurs extérieurs.
Le rôle des puissances occidentales fait également débat. Certaines capitales ont, dès les premières semaines de la guerre, appelé à un cessez‑le‑feu, mais les sanctions restent limitées et les ventes d’armes aux pays soupçonnés d’alimenter le conflit continuent. Les États‑Unis ont attendu décembre 2024 pour qualifier officiellement de crimes contre l’humanité et de nettoyage ethnique les exactions de la milice paramilitaire, sans que cela n’entraîne une réponse coordonnée. Les coupes budgétaires décidées par certaines administrations ont réduit l’aide humanitaire et la capacité opérationnelle des ONG sur le terrain. Pour les défenseurs des droits humains, l’inaction et le manque de volonté de certains États à faire respecter l’embargo constituent une forme de complicité.
De timides réactions internationales
Au fil des mois, l’Organisation des Nations Unies a multiplié les mises en garde. Le Conseil des droits de l’homme a prolongé en octobre 2025 le mandat de sa mission d’enquête au Soudan, malgré les objections des autorités de Khartoum. Des experts ont averti que les civils d’El‑Fasher couraient un risque imminent d’atrocités de masse, et le Secrétaire général a appelé à plusieurs reprises à une cessation immédiate des hostilités et à la protection des civils. Le Conseil de sécurité a prorogé le régime de sanctions en septembre 2025 et exprimé sa vive préoccupation face à la multiplication des violences sexuelles et des crimes à caractère ethnique. Les juges de la Cour pénale internationale affirment disposer de preuves solides de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis au Darfour, mais les mandats d’arrêt restent sans effet sur les chefs de guerre.
Dans plusieurs capitales, des voix s’élèvent pour demander des mesures plus fermes : gel des avoirs des commanditaires, embargo complet sur les armes à destination du Soudan et sanctions contre les États qui fournissent des armes ou financent les milices. Des organisations appellent également à créer un mécanisme international de protection des civils afin d’installer des zones de sécurité et de garantir l’acheminement de l’aide. Pourtant, la communauté internationale se limite souvent à des déclarations, et les appels à un cessez‑le‑feu restent lettre morte.
Un peuple pris en otage et un monde en sursis
Le conflit soudanais montre combien l’indifférence ou les intérêts géopolitiques peuvent prolonger des guerres meurtrières. Chaque jour, des familles enterrent leurs proches, des femmes cherchent leurs enfants disparus et des communautés entières sont réduites au silence. Les atrocités commises à El‑Fasher sont la répétition tragique de celles d’El‑Geneina et d’autres villes du Darfour, et préfigurent ce qui pourrait se produire ailleurs si rien n’est fait. La famine et les épidémies pourraient causer encore plus de morts que les balles et les drones.
La responsabilité ne se limite pas aux auteurs directs des massacres. Les compagnies qui vendent des armes, les États qui ferment les yeux sur les violations de l’embargo et les gouvernements qui préfèrent la realpolitik à la protection des civils portent une part de culpabilité. Tant que les armes continueront à affluer et que l’impunité sera la règle, les massacres se poursuivront.
Les populations soudanaises attendent une action à la hauteur du drame : un cessez‑le‑feu vérifiable, l’ouverture de corridors humanitaires, le désarmement des milices et une transition vers un pouvoir civil inclusif. Seule une mobilisation internationale résolue, libérée des calculs économiques ou géopolitiques, pourra briser le cercle de la violence. En l’absence d’une telle mobilisation, le monde demeurera complice, par son silence, de la tragédie en cours au Soudan.

La terreur criminelle de la guerre russe en Ukraine

La Tunisie vise l'autosuffisance en blé dur d'ici 2023

Pologne: Un mur pèse sur le tourisme local

G7: l'Ukraine demande des armes et des sanctions contre la Russie

Brics: Les dictatures s'accordent - la Chine et la Russie critiquent les sanctions occidentales

L’Union européenne accorde le statut de candidat à l'Ukraine

Severodonetsk: La terreur guerrière russe en Ukraine

Raketen für den Kreml! Soon for the Kremlin! Для Кремля! Bientôt le Kremlin! ¡Por el Kremlin!

Danke Ukraine, Thanks Ukraine, Merci l'Ukraine, Gracias Ucrania, Спасибо Украине, Obrigado Ucrânia

La soldatesque russe détruit les récoltes en Ukraine

Le bitcoin à l'aube de sa fin?




